Strategizing from 7 cities across the globe
Est-ce que l’Iran devrait posséder l’arme nucléaire?
Il peut paraître paradoxal de promouvoir la possession d’armes nucléaires au nom de la paix. Et pourtant, c’est bien la réalité du monde contemporain dans lequel nous vivons. Aujourd’hui, l’arme nucléaire n’est plus utilisée pour ses propriétés destructives, mais plutôt comme pion dans le jeu diplomatique, une méthode de dissuasion, un instrument de pression et parfois même un outil de chantage.
DROIT INTERNATIONALMOYEN-ORIENTGUERREÉTHIQUEPOLITIQUEFRANÇAIS
Chloé El-Khoury
6/29/202521 min read
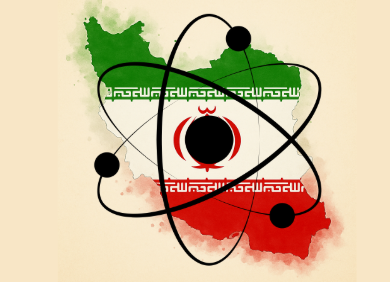
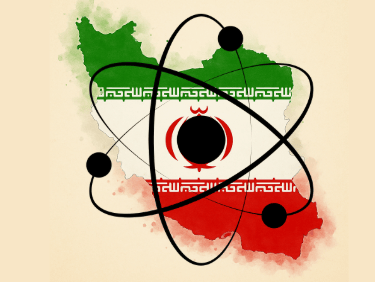
L’accord de 2015
Le 14 juillet 2015, l’Iran signe un accord historique avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU (États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie, Chine), ainsi que l’Union européenne : le Plan d’action global commun (ou Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA en anglais). Ce traité visait à encadrer et limiter le programme nucléaire iranien en échange de la levée progressive des sanctions économiques. Concrètement, l’Iran s’était engagé à réduire fortement son stock d’uranium enrichi, à démanteler deux tiers de ses centrifugeuses, à accepter des inspections strictes de l’AIEA, et surtout à renoncer au développement de l’arme nucléaire. En retour, les États-Unis et de nombreux pays européens ont alors levé des sanctions économiques, financières et pétrolières, libérant notamment près de 100 milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés.
Cet accord fut salué comme une réussite diplomatique majeure, un rare moment de consensus entre grandes puissances. Seul Israël, par la voix de son Premier ministre Benjamin Netanyahou dénonça « une erreur historique » et estima que l’accord ne supprimait pas complètement la capacité de l’Iran à développer une arme nucléaire, mais la repoussait simplement dans le temps à cause de ses clauses dites « à péremption » (ou Sunset provisions). En effet, de nombreuses restrictions du programme nucléaire iranien sont limitées dans le temps, précise le Council on Foreign Relations : par exemple, les restrictions sur les centrifugeuses devaient être levées après 10 ans, et celles sur la quantité d’uranium faiblement enrichi autorisée après 15 ans. Une fois les restrictions expirées (après 10 à 15 ans), l’Iran pourrait reprendre son programme nucléaire de façon légale. De plus, il permet à l’Iran de continuer à financer des groupes armés hostiles à Israël, comme le Hezbollah ou le Hamas, grâce à la levée des sanctions.
En 2018, sous Donald Trump, les États-Unis se sont résignés unilatéralement de l’accord (alors passé sous Barack Obama) et ont rétabli les sanctions économiques contre l’Iran, malgré l'opposition de leurs alliés européens. Trump a alors déclaré que l’accord était tellement « horrible » qu’il devait être abandonné pour pouvoir aller de l’avant : « L’accord avec l’Iran est défectueux en son cœur. Si nous ne faisons rien, nous savons exactement ce qui va se passer ». L'administration Trump affirmait à l’époque que l’Iran avait négocié le JCPOA de mauvaise foi, et que l’accord offrait trop à l’Iran en échange de trop peu. Les dirigeants de la troïka, composée de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni, avaient exprimé leur « regret et leur inquiétude » face à la décision de Trump, appelant l’Iran à continuer de respecter ses engagements malgré tout. Après l’assassinat de Qassem Soleimani, le chef de la force d’élite iranienne Al-Qods, lors d’une frappe américaine en janvier 2020, le gouvernement iranien a annoncé qu’il ne respecterait plus aucune des restrictons de l’accord qui sont imposées à son programme nucléaire. Depuis, l’Iran a progressivement repris certaines activités nucléaires autrefois gelées. Des négociations pour relancer l’accord ont eu lieu, mais sans résultat concret à ce jour (juin 2025).
Certains politologues considèrent le retrait des États-Unis de l’accord comme une erreur diplomatique majeure, motivée moins par une analyse stratégique que par une volonté de Trump de délaisser les décisions prises sous la présidence d’Obama.
Où en est l’Iran aujourd’hui ?
L’uranium est un métal radioactif, que l’on trouve à l’état naturel et dont l’atome qui le compose existe sous plusieurs formes, parmi elles l’uranium 235, seule forme capable de produire la fission nucléaire. Cependant, à l’état naturel, l’uranium ne compte que 0,7% d’U-235, ce qui en fait un élément très rare. Pour l’utiliser, il faut donc enrichir cette concentration, un processus très long que l’on réalise à l’aide de milliers de centrifugeuses, dans lequel plus on avance dans le taux d’enrichissement, moins ça prend de temps. Pour pouvoir l'utiliser dans des centrales nucléaires, l’enrichissement doit atteindre les 3 à 5%. Pour certaines utilisations médicales ou dans la recherche, ce taux peut même dépasser les 20%. Pour fabriquer une bombe atomique, le taux doit atteindre 90% d’enrichissement nécessaire. Aujourd'hui, l’Iran dépasse les 60%, un taux qui n’a plus de justification civile. Le programme étant trop avancé pour qu’il soit strictement civil, il n'y a donc presque aucun doute que l’Iran possède effectivement un programme nucléaire militaire non reconnu, mais il n'y a toujours pas de signe de fabrication d’une arme nucléaire en soit. Le 12 juin, l’AIEA avait pour la première fois en 20 ans, voté une résolution condamnant l’Iran de ne pas respecter ses obligations en matière de garantie nucléaires. Certains chercheurs de la FRS soulignent qu’une neutralisation par la force du programme nucléaire semble improbable, car celui-ci est sans doute déjà trop développé pour pouvoir le démanteler.
Qu’est-ce que le courant réaliste en relation internationale ?
Cela fait trente ans que Benjamin Netanyahou avertit la communauté internationale du programme nucléaire iranien et alerte sur la menace « imminente » que cela pourrait représenter au Moyen-Orient. Selon Israël, si l’Iran venait à se doter de l’arme nucléaire, il pourrait l'utiliser contre Israël, menaçant ainsi directement l’existence même de l’État hébreu. C’est cette dernière crainte que nous allons analyser et remettre en question aujourd’hui. Il est important de préciser que cette analyse se fera sous un point de vue précis, celui de l’approche réaliste.
Le courant réaliste est l’un des courants les plus dominants des relations internationales, promu par des penseurs comme Hans Morgenthau. Au sein de ce courant, on cherche à étudier la réalité internationale telle qu’elle est, et non pas telle qu’on aimerait qu’elle soit.
D’abord, étant donné que dans l’école réaliste, l'État est le seul acteur unique, unitaire et rationnel de la scène internationale, alors les organisations internationales n’ont aucune puissance et ne sont que des instruments aux mains des grands États. Par exemple, le conseil de sécurité de l’ONU est considéré comme une caisse de résonance de la puissance des membres permanents dotés du droit de véto, dont ils usent pour légitimer leurs actions.
Pour les réalistes, l’intérêt national est défini en termes de puissance, chaque État vise essentiellement, naturellement et constamment à défendre et accroître sa propre puissance politique et militaire. Il est donc impensable que les États acceptent de se soumettre à une autorité centrale qui les oblige à coopérer entre eux. C’est pour cette raison que la société internationale est considérée comme anarchique : l’état de nature de la société est la guerre et l'installation d’une paix perpétuelle est vu comme un idéal inaccessible. Vu ce climat d’insécurité, l’école réaliste préconise que chaque État soit amené à accroître ses capacités militaires, non pour agresser, mais pour survivre.
Or, l’inégale répartition des puissances, la méfiance mutuelle des états, la compétition, l’absence d’intérêts communs, la souveraineté et les ambitions étatiques, placent les états dans ce qu’on appelle un « dilemme de sécurité » : un État qui renforce ses capacités militaires pour se protéger sera paradoxalement perçu par les autres comme une menace, ce qui alimente la course à l’armement, parfaitement illustré aujourd’hui par le cas de l’Iran et des États-Unis.
Face à ce dilemme, les États disposent de deux choix : se ranger du côté de l’hégémon, c’est-à-dire du plus fort, ou bien tenter de rééquilibrer le rapport de force, via des alliances ou une montée en puissance. L’équilibre d’une région se trouve alors à un point précis : c’est une situation dans laquelle les capacités militaires sont équitablement réparties de sorte à ce qu’aucun État ne soit suffisamment fort pour dominer les autres. Historiquement, deux grands exemples illustrent ce principe : la Sainte-Alliance (1815–1914) en Europe, et la Guerre froide (1947–1991). La compétition militaire est donc encouragée car elle empêche une puissance de prendre le dessus sur une autre.
Ainsi, il est important de poursuivre cette analyse selon une perspective strictement réaliste.
La dissuasion nucléaire : facteur de paix ?
Si de nombreuses grandes puissances déchaînent aujourd’hui l’arme nucléaire, ce n’est pas sans raison. Malgré le fait que plusieurs de ces nations soient historiquement rivales, aucune guerre nucléaire n’a éclaté depuis la Seconde Guerre mondiale.
Cette absence de conflit nucléaire s’explique en grande partie par un principe fondamental de la science politique : la destruction mutuelle assurée (Mutually Assured Destruction, ou MAD, en anglais), ou l’équilibre de la terreur. Hérité de la guerre froide, ce concept repose sur l’idée suivante: Si deux pays possèdent suffisamment d’armes nucléaires pour se détruire complètement, alors l’attaque devient inévitablement suicidaire et aucun des deux n’a intérêt à attaquer l’autre, car cela entraînerait sa propre destruction aussi. Ainsi, l’équilibre des puissances reposent sur cette peur de la destruction totale, qui agit alors comme un puissant frein à l’escalade militaire. Cela rejoint l’idée centrale du réalisme : l’équilibre est garanti tant qu’aucun État n’a la capacité de dominer ou d'anéantir les autres sans craindre de représailles.
Un exemple emblématique de la doctrine de la destruction mutuelle assurée (MAD) est la rivalité historique entre les États-Unis et la Russie. Opposés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et tout au long de la guerre froide, ces deux puissances nucléaires n’ont pourtant jamais eu recours à l’arme nucléaire l’une contre l’autre. Un autre exemple est celui de l’Inde et du Pakistan : malgré des tensions profondes et récurrentes, ces deux pays dotés de l’arme nucléaire, évitent toute escalade vers une guerre totale. La dissuasion nucléaire agit ainsi comme un puissant frein, les poussant à la retenue par crainte des conséquences irréversibles. En revanche, si l’un des deux pays possédait l’arme nucléaire et que l’autre n’en disposait pas, le risque que celle-ci soit utilisée serait bien plus élevé. Pour le dire simplement : si deux personnes se tiennent en joue, pistolet sur le front, aucune n’a intérêt à tirer, car cela signerait leur propre fin. En revanche, si l’un est armé et l’autre désarmé, le risque d’ouvrir feu est bien plus élevé. Selon cette logique, l’armement est un outil de pacification.
C’est pourquoi de nombreux politologues soutiennent que, paradoxalement, les armes nucléaires peuvent contribuer à stabiliser certaines régions du monde et les rendre plus sûres. Dans une optique réaliste, la possession de l’arme nucléaire par l’Iran ne serait pas un facteur d’agression, mais de dissuasion. En réalité, en réduisant les déséquilibres de puissance militaire, les nouveaux États nucléaires tendent à apporter plus de stabilité régionale et internationale, et non moins.
Changer d’approche vis-à-vis de l’Iran
Partons du principe américain selon lequel l’Iran ne doit pas se doter de l’arme nucléaire. Quand on veut empêcher la prolifération nucléaire, il ne faut pas seulement s’attaquer à la capacité technique de fabriquer une bombe, mais aussi à la raison pour laquelle un pays voudrait en fabriquer une. Malheureusement, cet aspect est souvent négligé, en particulier aux États-Unis, où l’accent est mis soit sur les moyens techniques de limiter la diffusion des armes nucléaires, ou bien, lorsque ces moyens semblent voués à l’échec, sur des interventions militaires pour détruire la capacité nucléaire d’un État ou provoquer un changement de régime. Pourtant, cette approche technico-militaire fait largement abstraction du contexte politique et sécuritaire dans lequel les décisions nucléaires sont prises, ce qui a souvent aveuglé les analystes et les décideurs quant à d’autres options possibles.
Déjà, pour certains observateurs, si l’Iran était réellement déterminé à se doter de l’arme nucléaire, il finirait par trouver un moyen de le faire de manière clandestine. De plus, même après les récentes frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens (de la nuit du 21 au 22 juin 2025), une évaluation a conclu que l’Iran pourrait relancer son programme nucléaire en l’espace de quelques mois, selon trois sources, dont l’une a estimé que la reprise pourrait intervenir au plus tôt dans un délai d’un à deux mois. Ainsi, au lieu de recourir à la force, il est important de se demander : pourquoi l’Iran — ou tout autre pays — voudrait-il acquérir l’arme nucléaire ?
Après tout, de nombreux pays disposant des capacités nécessaires pour construire des armes nucléaires, y compris certains situés dans des zones de conflit réelles ou potentiellement, ont choisi de ne pas s’engager dans cette voie, comme le Japon ou la Corée du Sud. D’autres pays, tels que l’Afrique du Sud ou l’Ukraine, sont même allés jusqu’à démanteler leurs arsenaux nucléaires existant.
Un bon exemple est celui de la Libye, qui avait clairement entamé les démarches de base et les travaux nécessaires à la production d’une arme nucléaire. Pourtant, le dirigeant libyen Muammar Kadhafi a finalement renoncé à son programme. De son point de vue, cela faisait sens à la fois sur le plan politique et stratégique. Après tout, une bombe libyenne n’aurait offert aucun réel avantage dissuasif contre des pays qui, de toute manière, n’avaient pas l'intention d'attaquer la Libye. Une arme nucléaire aurait en outre consolidé, plutôt qu’atténué, le statut de paria de la Libye, et n’aurait eu que peu d’influence ou d’effet d’intimidation sur ses voisins. En revanche, l’abandon du programme nucléaire a permis la levée de toutes les sanctions économiques et une réintégration dans la communauté internationale occidentale. La décision de Kadhafi a été largement récompensée, sans coût apparent pour la sécurité ou le prestige de la Libye.
Mais alors, pourquoi l’Iran cherche l’arme nucléaire ?
L’Iran, bien sûr, se trouve dans un voisinage bien différent. Certes, les États-Unis et leurs alliés ont des raisons de s’inquiéter du comportement de l’Iran, notamment de son soutien à des groupes terroristes comme le Hezbollah. Mais l’Iran, lui aussi, a des raisons de s’inquiéter pour sa propre sécurité. Il s’agit ici d’analyser les raisons pour lesquelles l’Iran voudrait se doter de la bombe.
Déjà, son principal adversaire, les États-Unis, ont pendant de nombreuses années appliqué une politique de double endiguement visant à la fois l’Iran et l’Irak, tout en soutenant des groupes d’exilés déterminés à renverser le régime de Téhéran, y compris par des moyens violents. Le changement de régime à Téhéran a été un thème récurrent dans la politique américaine, tout comme dans celle d’Israël, qui a également fortement soutenu l’invasion américaine de l’Irak.
Ensuite, la guerre Iran-Irak de 1980-1988 a laissé un profond traumatisme dans la politique iranienne. Tous les pays occidentaux ont soutenu l’attaque de Saddam Hussein contre l’Iran et le conseil de sécurité des Nations Unis n’a jamais condamné cette attaque. Cette position a probablement conduit Saddam à penser (à juste titre) que les États-Unis ne réagissent que faiblement à son utilisation d’armes chimiques contre l’Iran. Depuis la révolution islamique de 1979, la politique américaine a consisté à refuser à l’Iran le droit de se défendre. Cette situation laisse l’Iran vulnérable face à un droit international qui a échoué à le protéger.
De plus, rappelons que dans la pensée réaliste, une région est dite équilibrée lorsque la force militaire est répartie de façon telle qu’aucun pays ne dispose d’une supériorité lui permettant de contrôler ou de menacer ses voisins. Dans le cas du Moyen-Orient, cet équilibre est rompu. En effet, le Moyen-Orient est la seule région au monde dans laquelle un seul État nucléaire non contrôlé existe. Dans toutes les autres régions du monde où il y a des États nucléaires, il y en a toujours au moins deux qui se surveillent mutuellement ou s’équilibrent. Mais au Moyen-Orient, Israël est le seul pays à posséder l’arme nucléaire, sans qu’aucun autre pays de la région ne puisse contrebalancer cette puissance, créant un déséquilibre stratégique majeur et un sentiment d’insécurité légitime chez ses voisins. Il n’existe donc aucune autre région du monde où un seul État doté de l’arme nucléaire reste sans contrepoids et où le pouvoir nucléaire n’est pas partagé ni contenu par un adversaire équivalent. C’est donc l’arsenal nucléaire israélien, et non le désir de l’Iran de s’en doter, qui a le plus contribué à la crise actuelle. Après tout, le pouvoir appelle naturellement un équilibre.
D’autant plus qu’Israël est l’un des seuls cinq pays au monde n’ayant pas signé le traité de non-prolifération nucléaire de 1968 visant à réduire le risque que l'arme nucléaire se répande à travers le monde, contrairement à l’Iran qui lui, l’avait signé. Israël possède des ogives nucléaires mais refuse tout contrôle de son programme nucléaire par l’AIEA. Le monopole nucléaire régional d’Israël, qui s’est révélé remarquablement durable au cours des quatre dernières décennies, a ainsi longtemps alimenté l’instabilité au Moyen-Orient.
Il est bien sûr facile de comprendre pourquoi Israël souhaite rester la seule puissance nucléaire régionale, et pourquoi il est prêt à recourir à la force pour préserver ce statut. En 1981, Israël a bombardé l’Irak pour empêcher toute remise en cause de son monopole nucléaire. Il a fait de même en Syrie en 2007, et aujourd’hui contre l’Iran. Mais les actions qui ont permis à Israël de préserver son avancée nucléaire à court terme ont aussi prolongé un déséquilibre qui est insoutenable à long terme.
La capacité prouvée d’Israël à frapper impunément ses rivaux nucléaires potentiels a inévitablement poussé ses ennemis à vouloir développer les moyens d’empêcher Israël de recommencer. Ainsi, les tensions actuelles ne doivent pas être vues comme les prémices d’une « crise nucléaire iranienne » récente, mais plutôt comme les derniers chapitres d’une crise nucléaire qui dure depuis des décennies au Moyen-Orient, une crise qui ne prendra fin que lorsque l’équilibre des puissances militaires sera rétabli.
On remarque ainsi que l’Iran possède une base objective de préoccupations sécuritaires et a donc pas mal de raison de vouloir se doter de l’arme nucléaire. Il serait plus intéressant pour les États-Unis de reconnaître les menaces objectives pesant sur la sécurité iranienne, et envisager des moyens de les atténuer, plutôt que d'attaquer des sites nucléaires qui pourraient redémarrer en quelques mois.
La crise autour du programme nucléaire iranien pourrait connaître trois issues possibles :
La première serait que la diplomatie, combinée à des sanctions sérieuses, parvienne à convaincre l’Iran d’abandonner sa quête de l’arme nucléaire. Mais cette issue est peu probable : l’histoire montre que lorsqu’un pays est résolu à se doter de l’arme nucléaire, il est rarement dissuadé. Sanctionner économiquement un État ne suffit pas à faire dérailler son programme nucléaire. Prenons l’exemple de la Corée du Nord, qui a tout de même réussi à fabriquer des armes nucléaires malgré d’innombrables sanctions et résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. Si Téhéran estime que sa sécurité dépend de la possession de l’arme nucléaire, il est peu probable que des sanctions changent d’avis. En réalité, ajouter encore plus de sanctions aujourd’hui pourrait même renforcer le sentiment de vulnérabilité de l’Iran, et le pousser encore davantage à chercher la protection que procure l’arme nucléaire.
La deuxième issue possible serait que l’Iran s’arrête juste avant de tester une arme nucléaire, et devient donc un état dit « de seuil », ce qu’on pense qu’elle est en train de faire actuellement. Un état de seuil est un état qui acquière une capacité dite de « breakout », c’est-à-dire un état qui a déjà développé toutes les technologies nécessaires au développement d’une bombe nucléaire sans toutefois franchir ce dernier pas qu’est la fabrication de la bombe en elle-même. L’Iran ne serait pas le premier pays à développer un programme nucléaire avancé sans construire de bombe. Le Japon, par exemple, dispose d’une vaste infrastructure nucléaire civile, et les experts pensent aisément qu’il pourrait produire une arme nucléaire en peu de temps s’il le décidait.
Une telle capacité de breakout pourrait suffire à répondre aux besoins politiques internes du régime iranien : elle rassure et donne le sentiment de bénéficier de tous les avantages liés à la possession de l’arme nucléaire (sentiment accru de sécurité), sans en subir les inconvénients (l’isolement international ou la condamnation générale). Mais ce calcul pourrait s’avérer inefficace : une capacité de breakout ne garantit pas que les autres pays interpréteront bien les intentions de l’Iran, ni que cela suffira à stabiliser la situation.
Les alliés européens se préoccupent avant tout de la militarisation du programme nucléaire, et pourraient donc accepter un scénario dans lequel l’Iran s’arrête juste avant de fabriquer une arme nucléaire. Les États-Unis et Israël, en revanche, ont clairement indiqué qu’ils considéraient le simple fait que l’Iran dispose d’une capacité d’enrichissement significative comme une menace inacceptable. Il est donc possible qu’un engagement vérifiable de l’Iran à ne pas aller jusqu’à l’arme nucléaire apaise les grandes puissances occidentales, sans pour autant satisfaire le couple États-Unis/Israël. Israël serait moins intimidé par une arme nucléaire virtuelle que par une véritable arme opérationnelle, et poursuivrait donc probablement ses efforts risqués pour saboter le programme nucléaire iranien par des opérations secrètes ou des assassinats ciblés. Cela pourrait alors pousser l’Iran à conclure qu’une simple capacité de “breakout” ne suffit pas à le protéger, et qu’il ne peut atteindre la sécurité qu’en allant jusqu’à la fabrication d’une arme nucléaire.
La troisième issue possible est que l’Iran poursuit sa trajectoire actuelle et déclare officiellement son statut nucléaire en testant une bombe. Les responsables américains et israéliens affirment que ce serait le pire scénario possible, affirmant qu’un Iran doté de l’arme nucléaire représenterait une menace existentielle et terrifiante. Mais un tel langage est typique des grandes puissances, qui ont toujours réagi violemment dès qu’un autre État a tenté de rejoindre le club nucléaire. Pourtant, chaque fois qu’un nouveau pays a réussi à se doter de l’arme nucléaire, les autres ont fini par s’adapter. Ce serait donc probablement le meilleur résultat envisageable : celui qui aurait le plus de chances de restaurer la stabilité au Moyen-Orient.
Si l’Iran a la bombe ?
Une des raisons pour lesquelles la menace d’un Iran nucléaire est largement exagérée, c’est que le débat a été faussé par des inquiétudes mal placées et une méconnaissance profonde du comportement des États dans le système international.
Il est vrai, afin que le principe de destruction mutuelle assurée fonctionne, il faut partir du principe que les acteurs en jeu sont des décideurs rationnels. Or le terrorisme a un caractère indéniablement irrationnel. En finançant de telles organisations, l’Iran alimente une crainte majeure selon laquelle son régime serait fondamentalement irrationnel. Pourtant, contrairement à une croyance répandue, la politique iranienne n’est pas dictée par des « mollahs fous », mais bien par des ayatollahs rationnels, qui, comme tout dirigeant, souhaitent avant tout survivre. Même si les responsables iraniens tiennent des propos provocateurs et haineux, rien n’indique qu’ils soient enclins à l'auto-destruction.
C’est pourtant exactement ce que font beaucoup d’analystes et de responsables aux États-Unis et en Israël. En présentant l’Iran comme irrationnel, ils soutiennent que la logique de la dissuasion nucléaire ne s’appliquerait pas à la République islamique. Ils affirment que, si l’Iran obtient une bombe, il n'hésitera pas à lancer une frappe nucléaire contre Israël, même si cela entraînerait une riposte massive et la destruction du régime iranien lui-même. Certes, on ne peut jamais être sûr des intentions de l’Iran, mais il est bien plus probable que son objectif soit d’assurer sa propre sécurité, plutôt que de renforcer sa capacité offensive (ou de se suicider). Intransigeant dans les négociations et défiant face aux sanctions, l’Iran n’en reste pas moins guidé par son instinct de survie.
Par exemple, en 2012, après que l’Union européenne a annoncé en janvier qu’elle allait interdire l’achat de pétrole iranien (ce qu’on appelle un embargo pétrolier), les dirigeants iraniens ont menacé de réagir fortement. L’une de ces menaces était de fermer le détroit d’Ormuz, un passage maritime stratégique par lequel transite une grande partie du pétrole mondial. Fermer ce détroit aurait provoqué un énorme choc économique mondial et une probable réaction militaire des États-Unis. Mais au final, l’Iran ne l’a pas fait. Il a préféré ne pas passer à l’acte, car il savait que cela déclencherait une riposte très violente des Américains, ce qui aurait mis en danger sa propre sécurité.
Aussi, après l’assassinat par les États-Unis du général iranien Qassem Soleimani en janvier 2020, l’Iran avait menacé de venger sa mort par de violentes attaques contre des bases américaines ou même des alliés régionaux. Finalement, l’Iran a lancé des frappes limitées sur des bases américaines en Irak (blessant quelques soldats mais sans morts), sans aller plus loin, pour éviter une escalade totale qui aurait pu mettre en péril la survie du régime.
Même certains observateurs qui reconnaissent la rationalité de l’Iran s’inquiètent tout de même qu’une arme nucléaire l’encourage à se montrer plus agressif ou à renforcer son soutien au terrorisme. Une inquiétude souvent exprimée est que l’Iran considère sa capacité nucléaire comme un bien au service du monde islamique, ou confie une arme nucléaire à une tierce partie comme un groupe terroriste. Un tel scénario est théoriquement possible, mais très peu probable. À l'exception notable, et rapidement regrettée, du transfert par l’URSS de certains matériaux fissiles à la Chine dans les années 1950, aucun pays disposant de matières fissiles utilisables pour fabriquer une bombe n’en a sciemment transféré à un autre acteur. D’ailleurs, aucun pays ne pourrait fournir une arme nucléaire sans être rapidement découvert. Les capacités de surveillance américaines et la capacité de traçage des matériaux fissiles rendent cela quasiment impossible. Et même un État comme l’Iran ne peut pas entièrement contrôler le comportement d’un groupe terroriste. Une fois qu’il aura acquis l’arme nucléaire, l’Iran aura tout intérêt à garder un contrôle total sur son arsenal. Après tout, construire une bombe est extrêmement coûteux et dangereux, il serait donc illogique de confier un tel outil à des acteurs ni fiables ni maîtrisables. Au contraire, l’histoire montre que les États deviennent plus prudents une fois dotés de l’arme nucléaire, conscients qu’ils deviennent alors des cibles potentielles des grandes puissances. Cette conscience les pousse à éviter les actions provocatrices. La Chine maoïste, par exemple, est devenue beaucoup moins belliqueuse après avoir obtenu la bombe en 1964. L’Inde et le Pakistan sont également devenus plus prudents depuis leur entrée dans le club nucléaire. En 1991, ces rivaux historiques ont signé un traité s’engageant à ne pas viser les installations nucléaires de l’autre.
Une autre inquiétude fréquemment évoquée est qu’un Iran nucléaire entraînerait une course à l’armement nucléaire au Moyen-Orient. Mais près de 70 ans après l’entrée dans l’ère nucléaire, ces craintes de prolifération généralisée ne se sont jamais concrétisées. Définie correctement, la « prolifération » signifie une diffusion rapide et incontrôlée, mais rien de tel ne s’est produit. Depuis 1970, on constate même un net ralentissement de l’émergence de nouveaux États nucléaires. Il n’y a donc aucune raison de croire que ce schéma changerait maintenant. Si l’Iran devenait le deuxième pays du Moyen-Orient à posséder la bombe depuis 1945, cela ne déclencherait probablement pas une réaction en chaîne. De plus, quand Israël a acquis l’arme nucléaire dans les années 1960, il était en guerre avec plusieurs de ses voisins. Son arsenal représentait une menace bien plus directe pour le monde arabe que le programme iranien aujourd’hui.
Si l’Israël nucléaire n’a pas déclenché une course aux armements à l’époque, il n’y a aucune raison de penser qu’un Iran nucléaire le ferait aujourd’hui. Si l’Iran devient la seconde puissance nucléaire de la région avec Israël, les deux pays se dissuadent mutuellement, comme l’ont toujours fait les puissances nucléaires. Il n’y a jamais eu de guerre totale entre deux États dotés de l’arme nucléaire. Une fois que l’Iran aura franchi ce seuil, la dissuasion s’appliquera, même si son arsenal reste relativement limité. Aucun autre pays de la région n’aura alors intérêt à développer sa propre capacité nucléaire, et la crise actuelle s'estompe enfin, conduisant à un Moyen-Orient plus stable qu’aujourd’hui. La diplomatie entre l’Iran et les grandes puissances doit se poursuivre, car le dialogue ouvert aidera l’Occident à mieux accepter un Iran nucléaire. Mais les sanctions actuelles peuvent être levées : elles touchent avant tout les Iraniens ordinaires, sans réel objectif. Si l’Iran venait à se doter de l’arme nucléaire, cela agirait comme un frein à toute guerre totale dans la région, garantissant alors un équilibre stratégique régional. En refusant à l’Iran cela, on maintient un déséquilibre structurel instable et potentiellement dangereux, sous prétexte de préserver une paix… qui n’existe pas.
Mais si l’Iran sait que posséder l’arme nucléaire l'oblige à mettre fin au conflit, alors qu’elle y est profondément ancrée idéologiquement, pourquoi choisirait-elle volontairement de s’imposer une telle limite ? C’est l’une des rares questions qui pourraient nous amener à penser qu’un Iran nucléaire serait suspicieux. En effet, cette étude est faite purement du point de vue réaliste, stratégique et militaire, mais quand l’idéologie entre en jeu, qui sait comment cela peut se terminer… ?
Télécharger l'article intégral
Sources
Le Parisien. « L’Iran sur le point d’obtenir la bombe atomique ? » YouTube, 21 juin 2025, www.youtube.com/watch?v=dJLsb7FYpQg.
Waltz, Kenneth N. “Why Iran Should Get the Bomb: Nuclear Balancing Would Mean Stability.” Foreign Affairs, vol. 91, no. 4, 2012, pp. 2–5. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/23218033. Accessed 29 June 2025.
Santos, Sofia Ferreira. Tulsi Gabbard now says Iran could produce nuclear weapon « within weeks » . 21 juin 2025, www.bbc.com/news/articles/c056zqn6vvyo.
Deliso, Meredith. « What was in the Iran nuclear deal and why did Trump withdraw the US from it ? » ABC News, 22 juin 2025, abcnews.go.com/Politics/iran-nuclear-deal-trump-united-states/story ? id=123020009.
